Suite de notre diffusion des planches de l'Encyclopédie, la quatrième partie du BOURRELIER ET BOURRELIER-BASTIER.
Toujours tirée de la première édition de l'Encyclopédie, ou Dictionnaire Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers de Diderot et d'Alembert (1750)
Nota : nous avons gardé l'orthographe originale quand celle-ci ne nuit pas à la compréhension.
Planche 4
Fig. 1. A, sous-barbe, le derrière de la muserole,
Fig. 1. B, muselière, le devant qui passe sur le nez.
Fig. 1. C œillères attachées aux montants, pour empêcher que le cheval ne voye de côté, qu'il n'ait peur, & ne soit distrait de son travail par les objets qui l'approchent.
Fig. 1. D, frontière, qu'on appelle frontail à un cheval de selle.
On orne quelquefois le côté de l'oreille en dehors d'un nœud d'oreille E, auquel on donne différentes formes. Ce nœud E s'attache à la jonction du montant & de la sous-gorge.
Fig. 1. F, gland qu'on y ajuste quelquefois, qui pend à côté de l'œillère.
Fig. 1. G, aigrette dont on orne aussi le dessus de la tête.
Fig. 2. Un des chevaux du milieu, lorsqu'on en attèle six à un carrosse.
Quand on attèle six chevaux, les deux du milieu, ou les quatrièmes, s'attèlent à une volée avec deux palonniers. Cette volée se met au bout du timon, & y tient par le moyen d'une chaînette de cuir.
On attèle les chevaux du milieu aux palonniers, comme ceux du timon, par deux traits pareils A, qui sont terminés à l'autre bout, ou du côté du poitrail par une boucle B, destinée à boucler les traits des sixièmes chevaux. Du reste, les harnois des uns & des autres sont composés seulement d'un poitrail D, d'un coussinet K, de deux barres de derrière N, pour soutenir le poitrail; de deux bois de bricole M, de deux surdos T, qui tiennent à une barre de croupière simple Z.
Fig. 3. Un des sixièmes chevaux, dont le harnois ne diffère du précédent, qu'en ce que les traits sont soutenus par des porte-traits L, qui tiennent à la barre de croupière. Quand on attèle à quatre, on ne met pas communément de volée, & on attache les traits O à ceux des chevaux de timon, ou à ceux de milieu, en faisant entrer l'extrémité O du trait dans la boucle B, fig. 2.



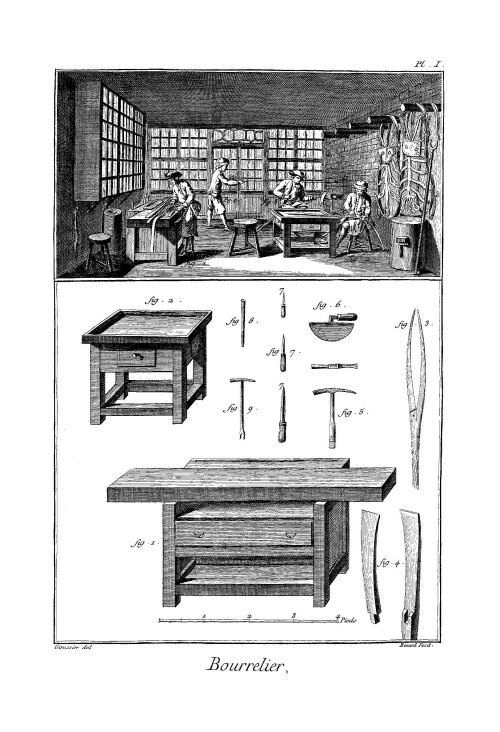
10 Derniers commentaires